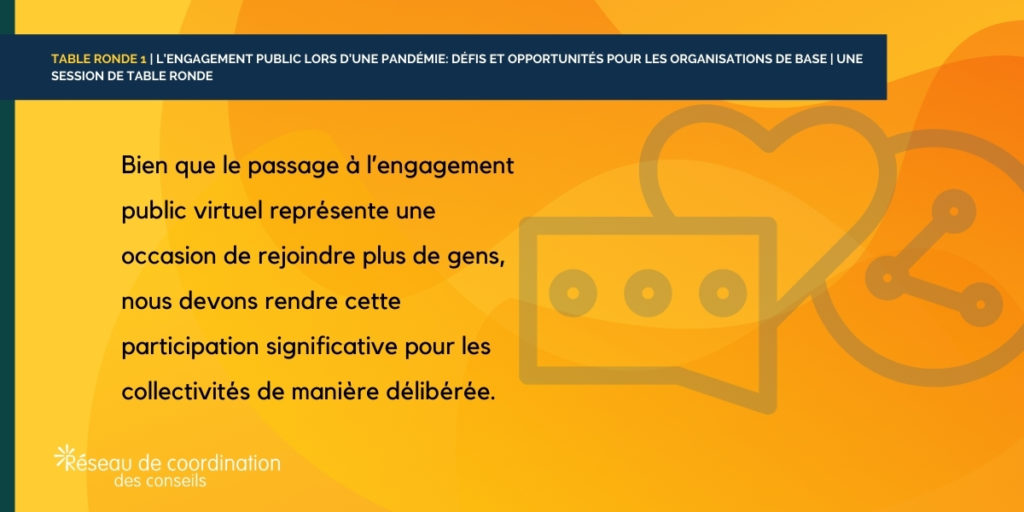
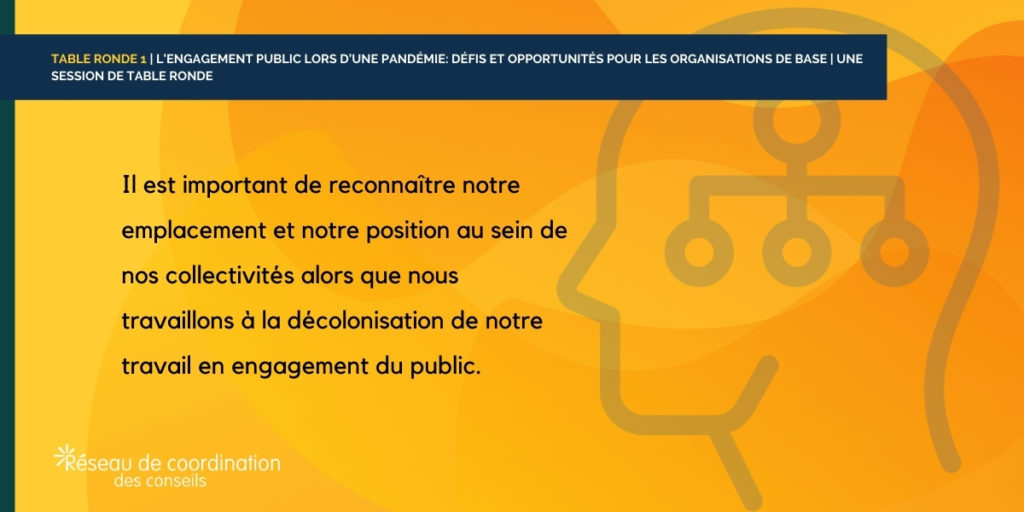
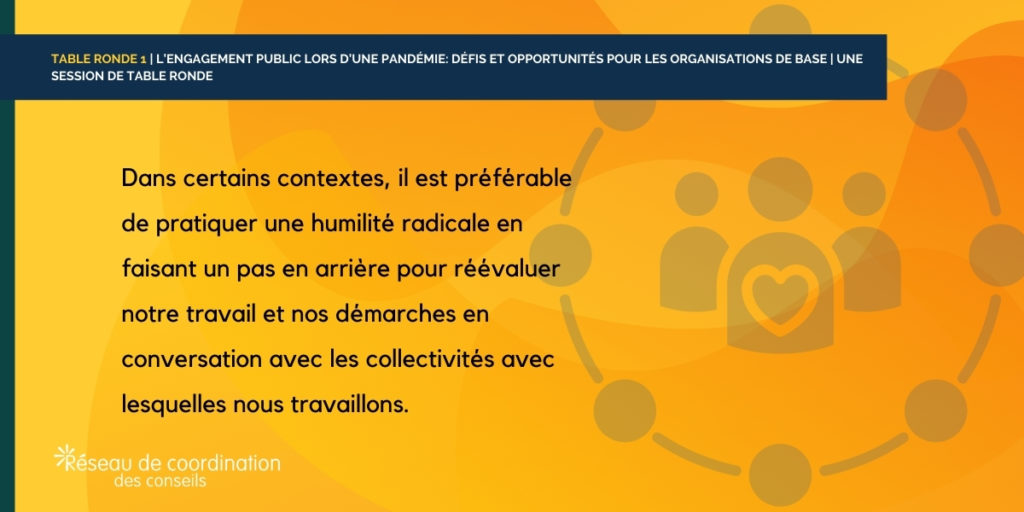
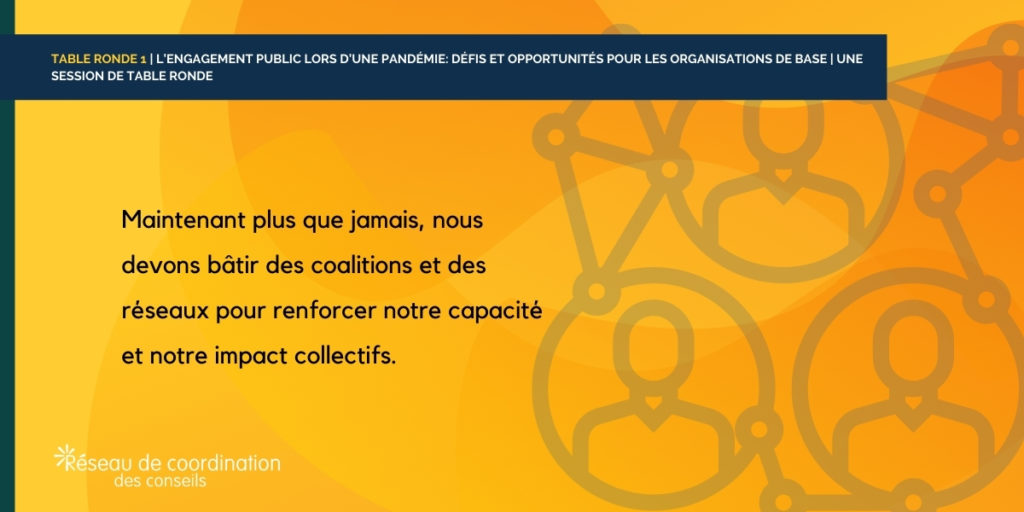
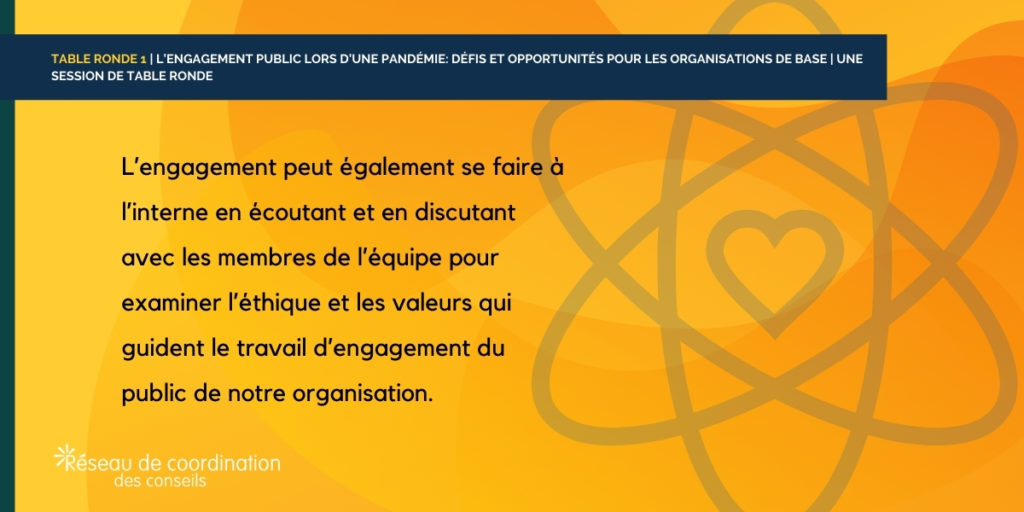
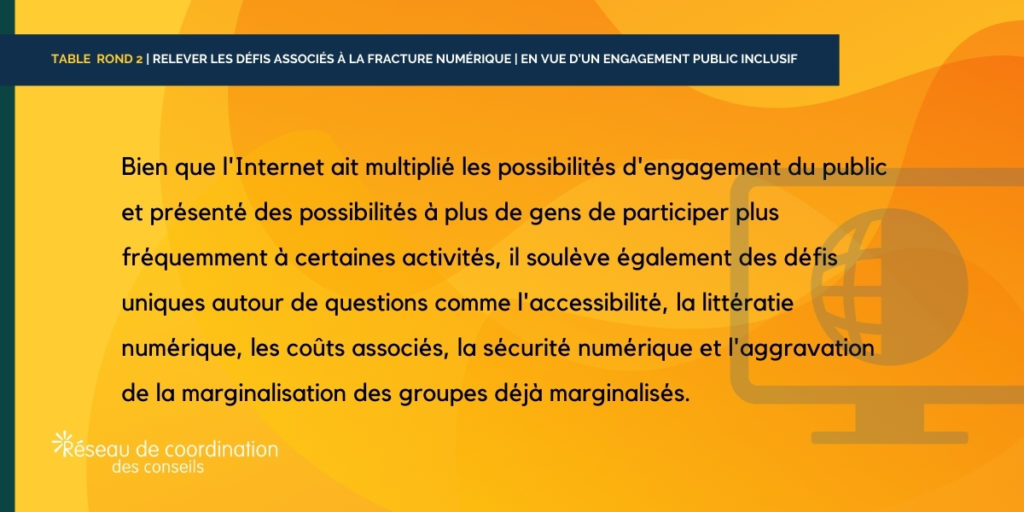
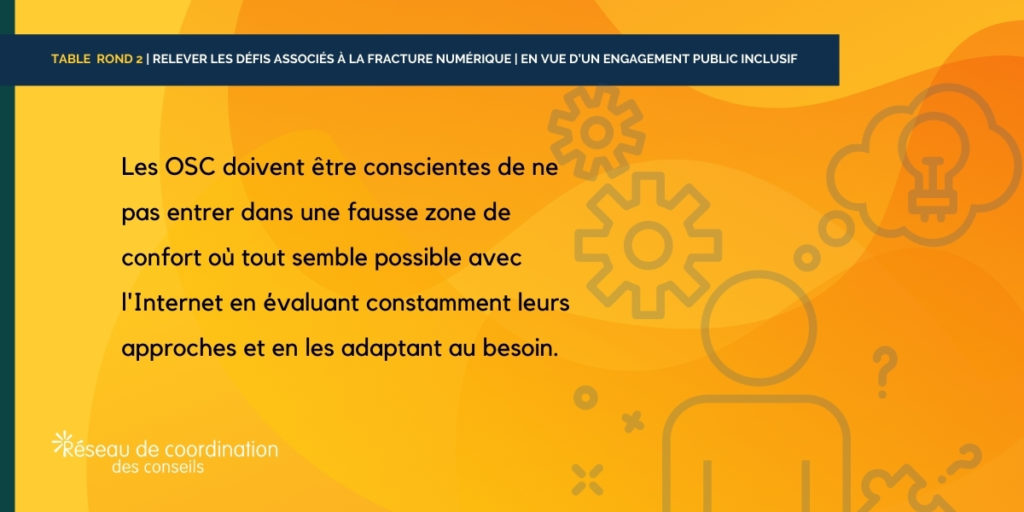
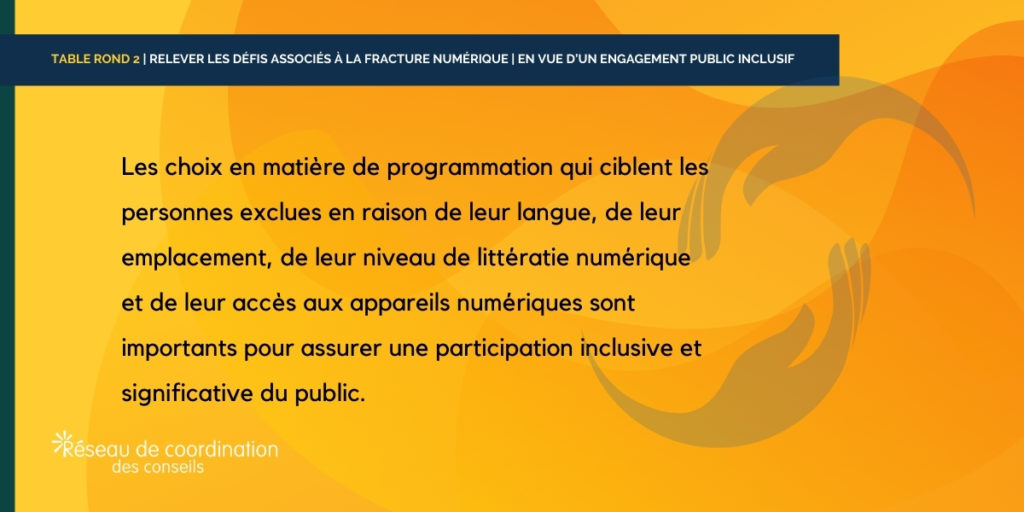
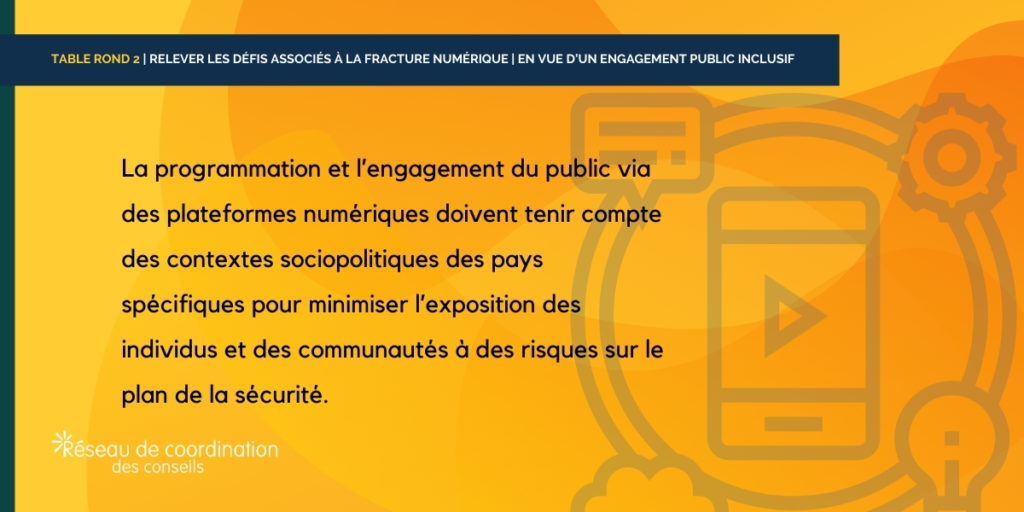
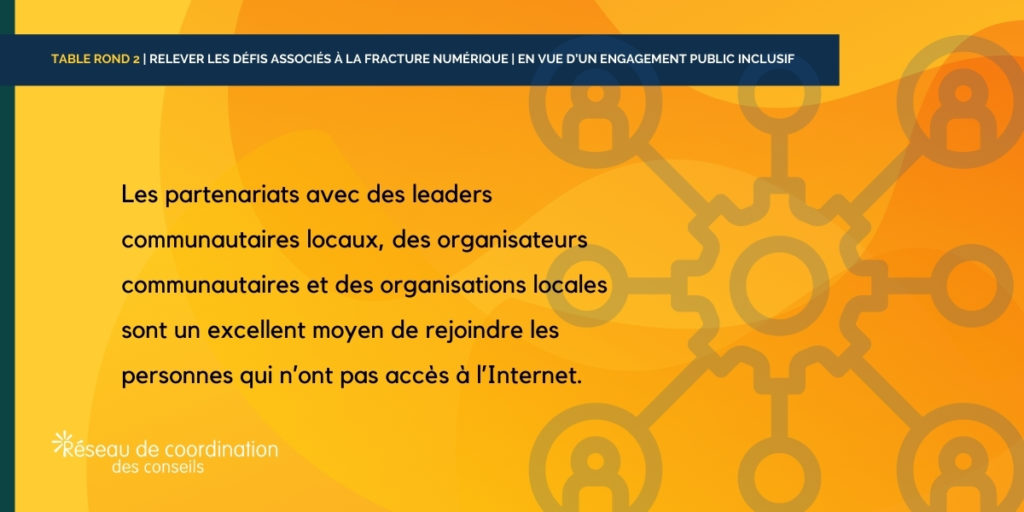
Afin d’examiner comment l’engagement du public a évolué pendant la pandémie, le Réseau de coordination des conseils (RCC) a organisé deux tables rondes virtuelles avec des organisations locales et de la société civile mondiale. Au cours de ces séances, les OSC ont discuté de l’impact des changements sur l’engagement du public et ont partagé des pratiques prometteuses pour une approche plus inclusive et transformatrice de l’engagement public durant et au-delà de la pandémie. Ces séances alimenteront également un projet de recherche plus large du RCC sur les approches féministes, antiracistes et décoloniales de l’engagement du public.
Pour commencer, le RCC aimerait reconnaître et remercier les personnes suivantes qui, à titre de représentantes et représentants de diverses OSC, ont participé aux tables rondes et les ont enrichies de leurs perceptions, expériences et expertises : Miriam Nobre ; Flora Trebi-Olennu ; Genevieve Huneault; Nohely Guzman ; Valerie Akinyi ; Ian Mangenga; Hailey Vidler; Prince Dela Yao ; Catherine Pappas; Daphne Morgen; Tina Sweeney; Sean Burke; Ruth Taylor; Rebecca Jacobs; Marina Melanidis ; Joy Masuhura; et Gabriel Newman.
La première table ronde portait sur l’évolution de l’engagement du public chez les organisations locales. Avec la pandémie, les organisations se sont réorientées et ont transféré une partie de leur travail d’engagement du public en ligne. Ce changement, bien qu’il soit difficile pour tout le monde, est plus facile pour les organisations qui possèdent déjà les ressources disponibles, l’expertise et l’infrastructure. Pour certaines organisations locales, le changement peut être plus difficile. En invitant des organisations locales du Canada, du Kenya, de l’Afrique du Sud, de la Bolivie, du Brésil et du Ghana, nos objectifs étaient de mettre en lumière les expériences uniques des organisations locales, d’apprendre de ces organisations locales et de comprendre la meilleure façon de les soutenir dans leur travail d’engagement du public.
Cette table ronde a réuni un groupe diversifié d’organisations locales comprenant Trebi Kuma Ollennu Foundation for Community Development, qui travaille à bâtir des collectivités en santé au Canada et au Ghana ; Engage Nova Scotia, qui travaille à l’avènement d’une société inclusive et résiliente en Nouvelle-Écosse ; Social Root Consulting, qui contribue à bâtir des pratiques d’affaires et de développement durables au Canada ; Jasy Renyhê, qui lutte pour les droits des femmes, ainsi que pour les droits et la reconnaissance des savoirs des peuples autochtones en Bolivie ; Digital Girl Africa, qui comble le fossé entre les femmes et la technologie en Afrique du Sud ; Making a Difference Sisters, qui lutte pour le bien-être des filles et des femmes au Kenya ; Sempreviva Organização Feminista, qui transforme les inégalités des relations de genre au Brésil ; et Development Complements, qui soutient des établissements de soins de santé au Ghana.
Les changement dans l’engagement du public ont élargi les possibilités pour les organisations locales. Les technologies numériques ont changé la forme et la fréquence des activités d’engagement du public ; il y a plus d’activités d’engagement du public, et plus de gens peuvent y participer de différentes manières. Cela a créé un espace pour des individus et des groupes qui traditionnellement n’auraient pas eu accès à certaines formes de participation. Bien que cette inclusion soit importante, le défi pour les organisations locales a été de rendre cette participation significative et transformatrice pour les groupes marginalisés. Cela peut inclure des décisions telles que des ajustements aux plateformes numériques utilisées pour l’engagement du public de manière à permettre une participation constante et sécurisée, ou de rediriger des flux de financement afin de permettre aux gens d’acheter des données sur Internet.
Chose tout aussi importante, la pandémie a mis au premier plan la question du travail de soin et les dynamiques qui façonnent ce travail de soin. Cette situation a sans aucun doute alimenté les réflexions des organisations locales dans le sens d’une réévaluation de leurs principes directeurs et des questions éthiques. Elles ont dû prioriser le travail de soin à l’interne, au niveau organisationnel, avec les membres de l’équipe et à l’externe avec les membres de la communauté et les partenaires, ce qui a mené à des changements dans les programmes, les projets et les relations avec les communautés, les partenaires et les bailleurs de fonds. Ce travail a mis fin à des relations tendues, renforcé des relations existantes et créé de nouvelles relations basées sur la confiance entre les organisations de la société civile, les partenaires de financement et les collectivités.
Ces possibilités sont toutefois jumelées à un ensemble unique de défis. L’Internet a simultanément élargi l’espace d’engagement du public et défavorisé encore davantage les personnes sans revenu disponible pour acquérir des appareils et se procurer un accès à Internet stable. Au-delà de l’accès, il y a d’autres fossés qui existent autour de la littératie numérique, du coût des données Internet, de la disponibilité d’appareils uniques ou multiples, de la sécurité numérique et de l’accessibilité. Comme l’a observé l’analyste des politiques Nanjira Sambuli, l’accessibilité et la disponibilité des technologies numériques ne mènent pas nécessairement à un monde plus équitable. Par conséquent, comme les mondes numériques deviennent importants, les organisations locales recommandent d’être plus conscients et sensibles par rapport à ces inégalités numériques pour éviter de (re) produire des formes d’inégalités.
La deuxième table ronde, qui portait sur la fracture numérique et l’engagement du public, a fait écho à la première et a réaffirmé ses perspectives. Des ressources inadéquates et une disponibilité inégale de l’infrastructure technologique déterminent l’accès de la population aux appareils et à l’Internet, qui détermine à son tour qui peut participer et, dans quelle mesure, aux activités d’engagement du public. Cette séance a mis l’accent sur des mesures spécifiques prises par les OSC pour s’assurer que les groupes marginalisés sont inclus de manière participative, significative et transformatrice.
Cette table ronde a rassemblé un groupe diversifié d’organisations de la société civile comprenant Heart Links, qui appuie le développement communautaire dans le nord du Pérou ; HOPE International, qui mobilise des ressources, des donateurs, des bénévoles et des équipes en faveur du changement dans le monde en mettant l’accent sur les infrastructures hydrauliques, la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance ; Community Forests International, qui travaille à la restauration et la conservation des forêts au Canada et en Tanzanie ; Youth for Nature, qui renforce la capacité des jeunes à travers le monde à se mobiliser en réponse à la crise écologique et climatique ; World Neighbours Canada, qui appuie des collectivités au Honduras, au Burkina Faso et au Népal ; Women Transforming Cities, qui aide à construire des villes où les filles et les femmes ont un réel pouvoir social, économique et politique ; Youth Unmuted, qui élève la voix des jeunes, particulièrement celles des jeunes déplacés en Grèce et au Mexique ; Cuso International, qui renforce le pouvoir et les capacités des collectivités mondiales à créer des changements durables et à favoriser les possibilités économiques, l’égalité des genres et l’amélioration de la santé ; Alternatives, qui milite pour la justice sociale et les droits humains.
Les OSC ont adopté différentes mesures pour naviguer les défis associés au fossé numérique mis en évidence plus tôt. Par exemple, faire des choix en matière de programmation pour cibler spécifiquement les personnes exclues en raison de leur langue, de leur l’emplacement, de leur niveau de littératie numérique et de leur accès aux appareils numériques est une manière de rejoindre de façon intentionnelle les groupes marginalisés. Pour assurer la sécurité des individus et des communautés dans les environnements politiques instables, les OSC basculent vers des plateformes numériques qui sont moins susceptibles d’être surveillées. Cela minimise les risques et encourage les gens à participer. Les OSC ont également adopté un système hybride qui combine la participation en ligne et hors ligne. De plus, établir des partenariats avec des leaders communautaires, des organisateurs communautaires et des organisations locales contribue à rejoindre des personnes qui n’ont pas accès à l’Internet.
En conclusion, il est évident à partir des discussions de ces tables rondes que la pandémie a a provoqué une réorientation de l’engagement du public. Un cadre plus éthique pour l’engagement du public est essentiel pour assurer une participation significative et transformatrice. Le RCC, par l’intermédiaire de ce projet de recherche, vise à fournir un leadership stratégique à cet égard. En collaboration avec des OSC locales et mondiales, le RCC souhaite explorer empiriquement et articuler un cadre éthique de l’engagement du public fondé sur des principes féministes.
Par Judyannet Muchiri, agente de politiques | judyannet@acic-caci.org
Judyannet est une défenseuse de l’égalité des genres, une chercheuse et une autrice. Son travail se situe à l’intersection du genre, de la jeunesse et du plaidoyer numérique. Elle possède de l’expérience de travail auprès d’organismes à but non lucratif au Kenya et dans d’autres pays africains dans les domaines de l’égalité des genres, la participation citoyenne et le plaidoyer numérique. Sa thèse de doctorat porte sur les espaces sûrs pour la participation citoyenne des jeunes femmes au Kenya. Judyannet écrit également de la fiction.








